Les sénateurs canadiens rencontrent les musulmans dans un contexte de haine antimusulmane
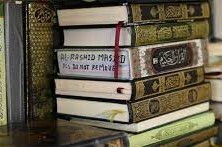
Les sénateurs ont tenu des audiences publiques d’une journée à Vancouver, à Edmonton, à Mississauga et à Québec, où ils ont entendu des témoignages passionnés et émouvants de nombreux dirigeants communautaires, d’intervenants, d’universitaires et de survivants de discrimination et de violence antimusulmanes.
« Pour cette étude, il était essentiel de tenir des audiences publiques, sur le terrain, dans les communautés qui ont été touchées par le racisme antimusulman », a expliqué la présidente du comité, la sénatrice Salma Ataullahjan.
« Les audiences ont permis aux sénateurs d’entendre une variété d’expériences vécues par des musulmans canadiens, de constater par eux-mêmes l’impact de l’islamophobie sur les musulmans canadiens et d’observer à quel point les communautés et les organisations ne ménagent aucun effort pour lutter contre l’islamophobie. »
Selon Statistique Canada, le nombre de crimes haineux signalés par la police ciblant les religions musulmanes en 2021 a augmenté de 71 % par rapport à l’année précédente. De plus, selon le Conseil national des musulmans canadiens le Canada est le pays du G7 où il y a eu le plus grand nombre de musulmans tués dans des attaques ciblées et motivées par la haine entre 2016 et 2021.
L’étude du comité sénatorial porte sur les sources de l’islamophobie au Canada et son impact sur les individus, ainsi que les incidents de discrimination, de violence physique et de haine en ligne envers les musulmans. Le comité vise à mieux comprendre la portée du problème au pays et à déterminer quelles mesures concrètes le Parlement et les autres pouvoirs doivent prendre.
Voici des thèmes et des questions clés qui ont été soulevés par des témoins lors des audiences et des visites d’études à des mosquées locales : la sous-déclaration des menaces et des violences motivées par la haine, la relation entre les communautés musulmanes et la police, les défis relatifs à la réglementation de la haine en ligne; et l’augmentation des investissements dans l’éducation antiraciste et la formation des témoins pour rendre les écoles et les communautés plus sécuritaires.
Des témoignages de partout au pays ont attiré l’attention sur la relation entre le genre, la race et la religion dans l’islamophobie, notamment le fait que les femmes musulmanes et les musulmans noirs sont plus souvent intimidés et ciblés. Certains se demandent si le terme « islamophobie » est encore adéquat pour décrire cette discrimination.
« Ce n’est pas une phobie. Cette peur se traduit par des actes, par des agressions physiques, par du chômage, par l’absence de promotion, par le fait d’être mis à pied et d’être l’objet de discrimination », a mentionné Neila Miled, la conseillère en matière de lutte contre le racisme de la faculté de médecine de l’Université de la Colombie-Britannique.
« C’est du racisme antimusulman. Il est lié à la race parce que nous sommes une communauté racisée. »
Au Québec, les sénateurs ont aussi entendu des témoignages sur la manière dont le projet de loi provincial 21 touche les femmes qui portent des hijabs et les communautés musulmanes dans leur ensemble, pour qui le souvenir de la tuerie de masse au Centre culturel islamique de Québec en 2017 est encore très présent.
« En tant que dirigeants, nous sommes prompts à condamner l’islamophobie à la suite de tragédies violentes, mais nous avons été lents à agir pour protéger les communautés musulmanes », a déclaré la sénatrice Amina Gerba, membre du comité.
« Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre plus longtemps. »
sencanada



